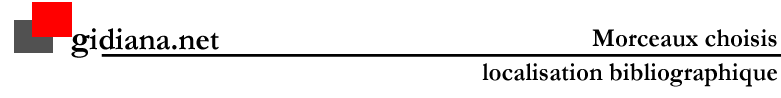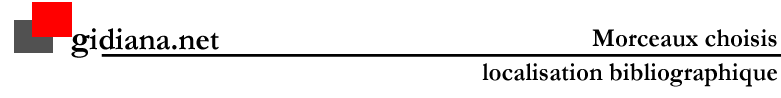
Pour un commentaire sur Morceaux choisis, voir les pages
que Charles Du Bos lui a consacré.
LOCALISATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
DES EXTRAITS
I
NATIONALISME ET NATIONALITÉ.
-- La Normandie et le Bas-Languedoc :
Juillet 1902, publié dans L'Occident, novembre
1902, repris dans Prétextes [1903], Mercure
de France,éd. 1945, texte intégral des pp. 61-66.
-- A propos des Déracinés de Barrès :
Décembre 1897, publié dans L'Ermitage,
février 1898, repris dans Prétextes
[1903], Mercure de France, éd. 1945, texte intégral
des pp. 45-52.
-- Journal sans dates (extraits) :
I. Nouvelle Revue Française, 1er août
1910, repris dans Nouveaux Prétextes [1911],
Mercure de France, éd. 1947, pp. 216-217 [de :
« Chaque année... » à :
« ses enfants chétifs. »] ;
pp. 218-219 [de : « Graines ailées... »
à : « la même culture. »].
II. Prétextes [1903], Mercure de France,
éd. 1945, pp. 98-99 [de : « Certains
nationalistes... » à : « comme
Atalante. »] ; p. 100 [de : « Il
y a des gens pour s'étonner... » à :
« loin d'être épuisée. »].
Puis deux extraits non repris : Nouvelle Revue
Française, 1er juin 1909, et un court extrait
daté « 1909 ».
-- Visites de l'interviewer
(Fragments) I :
L'Ermitage, janvier 1905, repris dans Nouveaux
Prétextes [1911], Mercure de France, éd.
1947, pp. 45-54. Ici : texte des pp. 50-54 [de :
« La politique, monsieur... » à la
fin].
-- Visites de l'interviewer II :
L'Ermitage, février 1905, repris dans Nouveaux
Prétextes [1911], Mercure de France, éd.
1947, pp. 55-60. Ici : texte des pp. 55-59 [du
début à : « il a vécu. »].
-- La théorie de Carey :
Nouvelle Revue Française, 1er novembre
1909 , repris dans Prétextes [1903], Mercure
de France, éd. 1945, pp. 77-84 [de :
« Abandonnons cette querelle... »
à la fin].
-- Réflexion sur l'Allemagne :
Nouvelle Revue Française, 1er juin 1919,
texte intégralement repris dans Incidences,
Gallimard [1925], éd. 1951, pp.11-21.
Retour à la
Table des matières
ART, MORALE ET LITTÉRATURE.
I.
-- La question de l'orthodoxie (Fragments) :
« En marge du Fénelon de Jules
Lemaître », Nouvelle Revue Française,
1er juin 1910, repris dans Nouveaux Prétextes
[1911], Mercure de France, éd. 1947, pp. 112-119.
Ici : texte des pp. 116-119 [de : « L'Eglise
a deux manières... » à la
fin].
-- La question du naturalisme (Fragments) :
Conférence prononcée à la Libre
Esthétique de Bruxelles, le 25 mars 1904. L'Ermitage,
mai 1904 , texte repris dans Nouveaux Prétextes
[1911], Mercure de France, éd. 1947, pp. 14-17
[de : « L'art ne consiste pas dans l'emploi... »
à : « meurt de liberté. »] ;
puis 24-26 [de : « Le moyen d'arracher... »
à : « du manteau des moeurs, le
héros. »].
-- De l'importance du public (Fragments) :
Conférence prononcée à la Cour de
Weimar le 5 août 1903, texte repris dans Nouveaux
Prétextes [1911], Mercure de France, éd.
1947, pp. 28-41. Ici : texte des pp. 32-40 [de :
« Ce fut une dangereuse chose... »
à : « enchaîné sur
le Caucase. ».
-- Individualisme :
10 décembre 1899. L'Ermitage, janvier 1900,
texte intégralement repris dans Prétextes
[1903], Mercure de France, éd. 1945, Dixième
lettre à Angèle, pp. 134-138.
-- Sincérité :
I. La Revue blanche, 15 février 1900.--
II. Nouvelle Revue Française, 1er janvier
1910, repris dans Nouveaux Prétextes [1911],
Mercure de France, éd. 1947, p. 169 [de :
« Le mot sincérité... »
à : « l'arc d'Ulysse. »].
-- La licence, la dépravation
et les déclarations de M. le Sénateur Béranger :
Repris dans Nouveaux Prétextes [1911],
Mercure de France, éd. 1947, texte intégral
des pp. 85-89.
-- Classicisme :
Repris dans Incidences, Gallimard [1925], éd.
1951, « Billets à Angèle »,
I, pp. 37-41 [de : « On est venu m'interviewer... »
à : « retentissement de la voix. »].
-- Pages diverses :
I. Nouvelle Revue Française, 1er septembre
1910, repris dans Incidences, Gallimard [1925],
éd. 1951, « Journal sans dates »,
pp. 78-79 [de : « Il n'y a d'art... »
à : « premier obstacle bu. »].
II. Nouvelle Revue Française, 1er février
1910, repris dans Nouveaux Prétextes [1911],
Mercure de France, éd. 1947, « Journal
sans dates », p. 150 [de : « Toutes
les grandes oeuvres... » à : « l'entend
mieux. »].
III. Repris dans Incidences, Gallimard [1925],
éd. 1951, « Feuillets », pp.
87-88 [de : « Dans ces vers de Baudelaire... »
à : « attrait). »].
IV. « Dialogue entre Racine et le Père
Bouhours », repris dans Incidences, Gallimard
[1925], éd. 1951, « Feuillets »,
pp. 85-86 [de : « Il est assurément
fâcheux... » à : « que
faire de mes conseils. »].
V. Nouvelle Revue Française, 1er août
1919, repris dans Incidences, Gallimard [1925],
éd. 1951, « Feuillets », pp.
89-90 [de : « Il est naturel... »
à : « authentique grandeur. »].
VI. Nouvelle Revue Française, 1er juillet
1910, repris dans Incidences, Gallimard [1925],
éd. 1951, « Feuillets », pp.
83-85 [de : « Le jour où La Rochefoucault... »
à : « beaucoup mieux entendues. »] ;
puis partiellement cité dans Dostoïevski
[ 1923], IV, Gallimard, éd. Idées NRF,
1964, p. 155 [de : « Le jour où
La Rochefoucault... » à : « s'en
être tenus là. »].
Retour à la
Table des matières
II.
-- Propositions :
Nouvelle Revue Française, 1er décembre
1911, repris dans Incidences, Gallimard [1925],
éd. 1951, « Feuillets », pp.
91-95 [de : « A l'occasion de son centenaire... »
à : « raisons d'excellence. »].
-- Préface aux Fleurs du Mal :
Ed. Pelletan, 1917, texte intégralement repris
dans Incidences, Gallimard [1925], éd. 1951,
pp. 159-163.
-- Baudelaire et M. Faguet :
Nouvelle Revue Française, 1er novembre
1910, repris dans Nouveaux Prétextes [1911],
Mercure de France, éd. 1947, texte intégral
des pp. 120-138.
-- Quelques jugements : Francis Jammes :
Nouvelle Revue Française, 1er juillet 1910,
repris dans Nouveaux Prétextes [1911], Mercure
de France, éd. 1947, « Journal sans dates »,
VII, pp.210-211, [de : « Ma fille Bernadette... »
à : « la beauté la joliesse. »].
-- Quelques jugements: Rémy
de Gourmont :
L'Ermitage, mars 1905, repris dans Nouveaux
Prétextes [1911], Mercure de France, éd.
1947, « Visites de l'interviewer »,
III, pp. 61-63, [de : « Les "grands
auteurs"... » à : « sur
nos pas jusqu'au bout. »].
-- Quelques jugements: Anatole France :
Nouvelle Revue Française, 1er février
1900 [sic], repris dans Nouveaux Prétextes
[1911], Mercure de France, éd. 1947, pp. 147-149,
« Journal sans dates », II, [de « J'aimerais
France... » à : « d'abord
préciosité. »].
-- Quelques jugements: Stendhal :
Nouvelle Revue Française, 1er janvier 1910,
repris dans Nouveaux Prétextes [1911], Mercure
de France, éd. 1947, « Journal sans dates »,
III, pp. 154-155 [du début à :
« végétation italienne...].
-- Les
dix romans français que... :
Nouvelle Revue Française, 1er avril 1913,
texte intégralement repris dans Incidences,
Gallimard [1925], éd. 1951, pp. 143-149.
-- L'amateur de M. Rémy de Gourmont :
Repris dans Nouveaux Prétextes [1911],
Mercure de France, éd. 1947, texte intégral
des pp. 102-111.
-- Les Mille Nuits et une Nuit :
I.-- L'Ermitage, août 1899, repris dans
Prétextes [1903], Mercure de France, éd.
1945, pp. 126-133. Ici : texte des pp. 126-131
[de : « Aujourd'hui je ne vous enverrai... »
à : « endormir ma pensée »].
II.-- « Dr J. C. Mardrus », Revue
blanche, 15 mars 1900, repris dans Prétextes
[1903], Mercure de France, éd. 1945, pp. 175-185.
Ici : texte des pp. 175-177 [de : « On
peut aimer ou ne comprendre point... » à :
« qu'Allah favorise ou non »] , et
182-185 [de : « Aussi bien, de toutes celles
des Nuits » à : « d'être
risqué »].
-- Nietzsche :
10 décembre 1898 [sic, mais 1899 dans Prétextes,
p. 152], repris dans Prétextes [1903],
Mercure de France, éd. 1945, « Lettres
à Angèle », XII, texte intégral
des pp. 139-152.
-- Considérations sur la Mythologie grecque :
Nouvelle Revue Française, 1er septembre
1919, texte intégralement repris dans Incidences,
Gallimard [1925], éd. 1951, pp.125-130.
Retour à la
Table des matières
II
-- Les Nourritures terrestres. I
1897, Romans, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1980, extraits
discontinus du Premier livre : pp.153-4 [du début
à : « détourne de Dieu »] ;
155-157 [de : « Où que tu ailles... »
à : « Pas la sagesse, mais l'amour. »] ;
165 [de : « Certes, tout ce que j'ai... »
à : « se diapre de mon amour. »].
Du Deuxième livre : pp. 168-170 [de :
« Où tu ne peux pas dire... »
à : « l'abri de ma sensualité. »] ;
174 [de : « Oh ! si tu savais... »
à : « bonheur. »] ;
180 [de : « Ah ! douce est l'herbe... »
à : « pour l'hiver. »].
-- Les Nourritures terrestres. II. Ménalque :
Ibidem, du Quatrième livre : 183-191
[du début à : « j'ai éperdument
adoré. »]. Du Huitième livre :
p. 241-242 [du début à : « pu
les goûter. »] ; 245 : [de :
« Oh ! si le temps... » à :
« (maintenant). »].
-- Les Nourritures terrestres. III. Envoi.
Ibidem, , p. 248.
-- Mopsus (Amyntas) :
L'Ermitage, mai 1899, texte intégralement
repris dans Amyntas [1906], éd. Folio,
1994, pp.13-21.
-- Le Renoncement au Voyage (Amyntas) :
Repris dans Amyntas [1906], éd. Folio,
1994, extraits des pp. 119 [de : « Tout
y contribuait... » à : « premier
contact »] ; 143-4 [de : « Si
peu nombreux... » à : « craquelures
si délicates »] ; Biskra :
121-125 [de : « Je rentre au coeur... »
à : « un bain brûlant. »] ;
145-6 [de : « Etait-ce, suite... »
à : « confondais avec elle. »] ;
135-141 [de : « Et quand j'en aurais dit... »
à : « souhaiter revenir » ;
148-9 [de : « Dans le petit jardin... »
à : « là-bas, encore... »] ;
Naples : 152-3 [de : « De la salle
à manger... » à : « malgré
lui »] ; Cuverville : 166 [de :
« J'aime l'été... »
à : « voyageât...! »].
-- Les Nouvelles Nourritures (fragments du Ier et du Ve
livres) :
Littérature, n° 1, mars 1919,
repris dans Les Nouvelles Nourritures [1935], Romans,
« Bibliothèque de la Pléiade »,
éd. 1980, tous les extraits sont dans le Livre
Ier : p. 254 [de : « Que l'homme... »
à : « humain de bonté. »] ;
254-5 [de : « Je ne sais trop... »
à : « t'asservir. »] ;
256-258 [de : « De l'amour et de la pensée... »
à : « spontanéité »] ;
259-260 [de : « C'est la reconnaissance... »
à : « à moi du bonheur »] ;
266 [de : « Je ne trouve pas... »
à : « royaume de Dieu. »].
Retour à la
Table des matières
III
-- Le Retour de l'Enfant prodigue :
1907, Romans, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1980, texte
intégral des pp. 475-491.
-- Ajax :
1900, acte Ier, scène 1, Minerve et Ulysse, texte
intégralement repris dans les Oeuvres complètes,
t. IV, pp. 369-374.
Retour à la
Table des matières
IV
-- André Walter (extraits)
1891, Gallimard, éd. Folio, 1986, « Le
Cahier blanc », pp. 45-47 [de : « C'était
un soir d'été... » à :
« intimité plus secrète. »] ;
pp. 56-57 [de : « Puis le les ai tant
séparés... » à : « objet
de scandale. »] ; p. 65 [de :
« J'écrivais à Pierre... »
à : « tes yeux s'abaissent. »].
-- L'Immoraliste (Les trois rencontres avec Ménalque) :
1902, Romans, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1980, IIe
partie, chap. II, texte intégral des pp. 424-429
[de : « Pourtant je n'aurais su dire... »
à : « quelque temps sans le revoir. »] ;
et pp. 429-438 [de : « Ce fut chez
moi... » à : « trébuchais
tout entier. »].
-- La Porte étroite (Journal d'Alissa) :
1909, Romans, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1980, texte
intégral des pp. 581-595 [du début
à : « de nouveau que je suis seule. »].
-- Le Prométhée mal enchaîné.
I. Discours de Prométhée :
1899, Romans, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1980, « La
Détention de Prométhée »
IV-VIII, pp. 320-326 [de : « Dans
la salle des Nouvelles Lunes... » à :
« c'est celles-là que je dirais. »].
-- Le Prométhée mal enchaîné.
II. Histoire de Tityre :
Ibidem, pp. 335-336 [de : « Au
commencement était Tityre... » à :
« excessivement occupée. »].
-- Les Caves du Vatican (Deuxième livre : Julius
de Baraglioul) :
1914, Romans, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1980, Livre
II, chap. I-V, texte intégral des pp. 707-730
[du début à : « deux bouches
plus loin "de Baraglioul". »].
-- Les Caves du Vatican. (Extrait du 5e livre: Lafcadio) :
Ibidem, Livre V, chap. I, texte intégral
des pp. 821-829.
-- Les Faux Monnayeurs: Journal de Lafcadio (extraits) :
Repris dans l'appendice du Journal des Faux-Monnayeurs
[1927], Gallimard, éd. 1980, pp. 103-107.
Retour à la
Table des matières
V
-- Oscar Wilde
(fragments) :
L'Ermitage, juin 1902, repris dans Prétextes
[1903], Mercure de France, éd. 1945, pp. 221-252.
Ici : texte des pp. 234-248 [de : « Ici
commencent les souvenirs tragiques... » à :
« pas de première personne. »].
-- Conversation
avec un Allemand quelques années avant la guerre :
Nouvelle Revue Française, 1er août
1919, texte intégralement repris dans Incidences,
Gallimard [1925], éd. 1951, pp. 133-140.
-- Pages inédites :
I.-- Repris dans Journal 1889-1939, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1951, pp. 775-777.
-- Journal, « Bibliothèque de
la Pléiade », éd. 1996, t. I,
pp. 1238-1240 [du début à : « de
sérénité. »].
II.-- Repris dans Journal 1889-1939, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1951, pp. 777-778.--
Replacé à la date du 20 janvier 1919 dans
Journal, « Bibliothèque de la
Pléiade », éd. 1996, t. I,
pp. 1100-1101 [de : « T. s'explique... »
à : « du bonheur et de l'harmonie »]
.
III.-- Repris dans Journal 1889-1939, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1951, pp. 778-780.--
Journal, « Bibliothèque de la
Pléiade », éd. 1996, t. I,
pp. 1240-1242 [de : « J'étais
pareil au fils... » à : « dans
l'inconnu. »].
-- Hérédité
(Si le Grain ne meurt) :
Nouvelle Revue Française, 1er février
1920, repris dans Si le Grain ne meurt, I, I, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1972, p. 358,
[de : « Les vacances du nouvel an... »
à : « d'aucun grand homme, d'aucun
héros. »].
-- La querelle du
peuplier :
L'Ermitage, novembre 1903, repris dans Prétextes
[1903], Mercure de France, éd. 1945, texte intégral
des pp. 53-60.
-- A propos de M.
Barrès :
1910, repris dans Journal 1889-1939, « Bibliothèque
de la Pléiade », éd. 1951, p. 666.-- dans
Journal, « Bibliothèque de la
Pléiade », éd. 1996, t. I,
texte intégral de la p. 1087.
-- Réponse
à une enquête (Influence allemande) :
1903, repris dans OEuvres complètes, Gallimard,
t. IV, 1933, texte intégral des pp. 413-414.
-- Réponse
à une interview de La Renaissance sur le Classicisme :
8 janvier 1921, texte intégralement repris dans
Incidences, Gallimard [1925], éd. 1951,
pp. 211-212.
-- Théophile
Gautier :
Conférence au Théâtre du Vieux-Colombier,
avril 1914, texte intégralement repris dans Incidences,
Gallimard [1925], éd. 1951, pp. 153-155.
|
La signification des Morceaux
choisis de Gide, selon Charles Du Bos
En fait si radicale est ici la divergence des tempéraments
[entre Gide et Wilde] que, dans le diptyque humain auquel j'ai
fait allusion, Wilde -- et rien ne le montre mieux que son échec
à intégrer d'une manière durable l'expérience
de De Profundis -- représente l'élément
de [241] la figure, et comme le volet de fixité, cette
« fidélité au type » que, Grec né
hors de saison, il rejoint par le détour de la personnalité,
d'une personnalité accusée en son contour, mais par
là même inapte au renouvellement;-- Gide, tout à
l'inverse, l'élément protéen, l'esprit
de métamorphose qui ne se sent fidèle qu'alors que fidèle
à son infidélité, qui rencontre la perfection
du sens qui lui est propre à l'heure de la phrase du Ménalque
des Nourritures terrestres : « Ainsi ne traçai-je
de moi que la plus vague et la plus incertaine figure, à force
de ne la vouloir point limiter. » Jamais trop vague ni trop
incertaine en pareil cas, car la raion d'être de Protée,
c'est de n'avoir point de figure (1). Or, -- et
nous abordons ici un des détours tout ensemble les plus singuliers
et les plus critiques du labyrinthe gidien -- un moment vint où
Ménalque-Gide ne se contenta plus « de tracer de
lui-même la plus vague et la plus incertaine figure »,
où, sans consentir de ce fait à « se limiter »
(nous savons que Gide et ses associés, que ceux-ci s'appellent
Edouard ou Ménalque, excellent à éluder le principe
de contradiction), il a souhaité, voulu, non plus cette fois
tracer avec ce que le mot comporte encore de presbytie impondérable,
mais dessiner d'un trait net, assuré, une figure, comment dirai-je ?
disons de la virtualité elle même. A ce désir,
à cette volonté, correspond l'entreprise en soi si sujette
à caution, mais, pour la connaissance de Gide, à tel
point symptomatique que représentent les Morceaux Choisis. Je n'insiste pas sur le fait
que jusqu'à présent un écrivain laissait à
ses successeurs le soin de procéder à des choix de cet
ordre ; j'y insiste d'autant moins que depuis la publication
de Si le Grain ne meurt nous savons le peu de cas que fait
Gide de la catégorie posthume. Ce qui m'intéresse, ce
qui me requiert ici, c'est que l'homme qui par principe se refuse
à tout choix dans les domaines où il est presque impossible
[242] de ne pas choisir accueille, hospitalise la notion de choix
dans un des seuls domaines précisément où il
y aurait lieu de l'exclure : bien loin de lui être cette
fois « intolérable », il semble que « l'option »
rencontre sa faveur alors précisément qu'elle n'offre
nulle « nécessité ». On dira peut-être
que c'est là le geste d'un artiste conscient qui souhaite,
en les groupant lui-même, désigner celles de ses oeuvres
ou de ses pages qu'il estime les plus belles, et que donc ici comme
ailleurs l'opération relève de la seule esthétique.
Je le veux bien, pour une part, admettre, mais je n'en suis pas moins
convaincu qu'il n'y a pas ici que cela. Relisons le bref avertissement
dont est précédé le recueil de 1921 : « Un
volume de pages choisies spécialement à l'usage de la
jeunesse paraît concurremment chez Crès. Il nous a paru
que nous devions dans ce volume-ci donner la préférence
aux pages les plus significatives d'un auteur auquel les critiques
ont souvent reproché de se dérober. Un grand nombre
de ces pages sont extraites de livres devenus a peu près introuvables.
D'autres ont paru en revue mais n'avaient pas encore été
reprises en volume ; certaine enfin sont inédites. »
-- « Les pages les plus significatives d'un auteur auquel
les critiques ont souvent reproché de se dérober »,
-- voilà la petite phrase révélatrice d'un dessein
en tout état de cause périlleux, mais ici d'autant plus
qu'en opposition insurmontable avec les données du cas. Si
jusqu'à l'après-guerre en effet (mais il est vrai que
celle-ci marque une revanche éclatante) ce n'était pas
aux auteurs eux-mêmes qu'il appartenait de statuer sur les différents
degrés de signification de leurs propres pages, pour pouvoir
du tout se livrer à cette opération, Ménalque-Protée
ne dispose que de deux recours : ou se renier en tant que protéen,
ou (c'est la solution adoptée dans lesMorceaux Choisis), conduisant à l'extrême
chacune de ses virtualités, aboutir -- ainsi que je l'ai montré,
à la fin du Cinquième Entretien, sur deux textes essentiels,
et les Morceaux Choisis
en fourniraient bien d'autres exemples -- à mettre à
chaque coup en échec le principe de contradiction : exercice
attrayant sans doute, mais aussi un peu facile pour un esprit de la
classe de Gide. « ...un auteur auquel les critiques ont
souvent reproché de se dérober » : grâce
non seulement à son incorruptibilité d'artiste, mais
à ses tirages restreints et à ses perpétuelles
absences, Gide était parvenu à retarder plus longtemps
peut-être qu'aucun autre [ 243] l'heure que signale mon Journal
de 1912, l'heure où l'artiste commence à voir une image
de lui-même dans le miroir de l'esprit public : il avait
sincèrement voulu et il avait su éluder la figure ;
-- mais, pour le meilleur et pour le pire, un des traits les plus
enracinés de cette nature, c'est de ne jamais pouvoir supporter
ses réussites ni s'y tenir : il a trop bien réussi
à éluder la figure, aussitôt il se persuade qu'il
a tort, qu'il se doit (et sur un plan, répétons-le,
tout désintéressé : c'est par là
qu'en ces zones Gide est si curieux et si attachant à observer)
d'en avoir une (2) ; il n'a pris encore aucune
position, il les prendra toutes, et chacune d'elles -- comme je l'indiquais
plus haut -- il la prendra trop bien, si bien qu'il en oubliera les
autres ; puis, en vertu de leur signification, et sous le signe
(qui lui est toujours si cher) de la simultanéité, en
ces arènes non sanglantes que constituent les Morceaux
Choisis, il affrontera tous ces frères ennemis, -- tandis
que, sans nulle angoisse sur leur sort ni sur le nôtre, nous
élisons, selon nos préférences individuelles,
tels ou tels cristaux que, pour les mieux apprécier encore,
nous élevons un moment dans la lumière; -- et nous nous
disons que si Protée veut à tout prix avoir une figure,
celle de l'artiste en tout cas ne lui fera jamais défaut.
Charles Du BOS, Le Dialogue
avec André Gide, Corréa, 1946, pp. 240-243.
[Les chiffres insérés
dans le texte entre crochets droits [243] renvoient à la pagination
du livre].
(1) Nous
touchons à un point si délicatement complexe que je
veux dès l'abord prévenir toute possibilité de
malentendu. Entre la notion de figure que je vise et cherche
à définir ici et l'attitude impliquée dans l'expression
courante « faire figure », il n'existe non seulement
aucun rapport, mais même aucun territoire commun. « Mon
Dieu, donnez-moi de ne pas être de ceux qui font figure dans
le monde. Donnez-moi de ne pas être de ceux qui réussissent.
Donnez-moi de ne pas compter parmi les heureux, les satisfaits, les
repus ; parmi ceux qu'on applaudit, qu'on félicite et
qu'on jalouse », est-il dit dans Numquid et tu ?...
A cet égard Gide s'est toujours montré d'une constance
irréprochable, il n'a jamais pactisé ni avec le succès,
ni avec les honneurs : personne aujourd'hui n'est plus ferme,
plus grave faudrait-il dire lorsqu'une question de moralité
littéraire est en jeu.
(2) En
ce qui concerne le phénomène qui nous occupe, il convient
d'ajouter que l'admirable modestie de Gide a cette dangereuse conséquence
que, pour intransigeant qu'il soit sur l'essentiel, il est des plus
sensibles à l'incompréhension. Dans le domaine de l'incompréhension,
il tient compte de tout, même de ce qui ne compte pas :
comme ces maîtres ès compréhension qu'étaient
la plupart des critiques d'avant-guerre décrétaient
à tout propos que l'oeuvre gidienne était la plus inconsistante
qui fût, que de leur côté, succombant au piège
de penser par réaction, tels amis l'incitaient à préciser
sa ligne, Gide qu'habitait alors le souci croissant du dessin -- et
qui comme nous tous, accueille surtout les conseils quand ils coïncident
avec le secret désir du moment -- fut sans doute ainsi conduit
à accorder importance à la notion en son cas contradictoire
de figure.
|